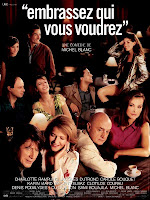Quand, à la fin de l'année, viendra l'heure des bilans et qu'il me faudra choisir parmi les pires films vus en 2012, j'hésiterai longuement, comme toujours. J'hésiterai en me demandant quel est le film dont il faut à nouveau rappeler toute la nullité et quel est le réalisateur qui mérite le plus qu'on lui tape encore dessus. Je penserai d'abord à des petits pets dans la brume comme
After.Life ou
L'Amour dure trois ans, mais, bien conscient que ces choix très consensuels ne choqueraient personne, je renoncerai assez vite à les citer, regrettant tout de même de ne pas saisir l'occasion de dire encore une fois tout le mal que je pense du dénommé Frédéric Beigbeder et de toute sa petite bande. Je songerai ensuite à
Un Heureux évènement, puis je serai dégouté de voir qu'il est sorti fin 2011. A la recherche du vrai film de merde ultime, ma pensée s'orientera alors vers ceux que j'aurai jugés les plus dignes de tout mon mépris. Je penserai donc aux plus détestables, aux plus dangereux, aux plus affreux longs métrages subis durant l'année civile. Et là, à coup sûr, le très douloureux souvenir de
Detachment m'apparaîtra comme une évidence, de la même façon que
Polisse s'était imposé à moi comme la pire saloperie sortie sur grand écran au cours de l'an de grâce 2011. Mais vous verrez, ces deux films partagent plus d'un point commun...

Réalisateur de clips musicaux, de publicités et de documentaires, Tony Kaye a cru juger bon de mêler tous ces styles dans un même film. Le résultat est une bouillie des plus infâmes que l'on regarde béatement comme fasciné par tant de laideur et de bêtise. Detachment, c'est 100 minutes tout rond, pas une de plus ni une de moins, de viol oculaire et de harcèlement cérébral. Mes mots sont brutaux, certes, mais le film l'est bien plus, croyez-moi. Tony Kaye ne nous lâche pas une seconde. Dès le générique d'ouverture, dont vous trouverez des copies un peu plus soignées sur Deviantart ou Viméo, le réalisateur nous prend dans son étau pour ne nous en libérer qu'à l'apparition tant espérée de l'écran noir final. Avant cela, Kaye consacre son temps à nous essorer, à nous presser, comme si son objectif numéro un était de nous vider de tous nos espoirs et de toute notre foi en l'être humain. Après avoir vu son film, on se dit qu'il n'y a rien à faire, que tout est perdu. Le récit dégueulasse qu'il nous offre de l'expérience de Henry Barthes (Adrien Brody), ce prof remplaçant assigné pendant trois semaines dans un lycée difficile de la banlieue new-yorkaise, agit comme un coup de massue fatal, directement porté à notre envie de vivre et à nos convictions humanistes. Je ne déteste rien de plus que ces films qui veulent dresser le portrait alarmant d'un système, d'un milieu, d'une société, sans offrir la moindre espérance, comme s'il s'agissait d'un état de fait irrévocable, et en utilisant les plus infâmes et tristement efficaces procédés, ceux-là même qui coulent notre monde et anéantissent toute envie d'agir. Un bon coup dans la fourmilière, ça a parfois du bon, mais y aller au bazooka, c'est pas super malin. Il faut penser aux dommages collatéraux. Faut-il être un dangereux malade pour consacrer au moins six mois de sa vie à la conception d'un film qui s'échine à vouloir nous dire que rien ne va plus. N'y a-t-il pas eu une seule journée de tournage où Tony Kaye s'est levé du bon pied, avec la banane et l'envie de nous offrir une petite éclaircie au milieu du nuage cafardeux et pollué d'idées noires qu'est son film ignoble ? Il faut croire que non... En ce qui me concerne, il y a bien des matins où je ne suis pas d'humeur, mais cela ne dure pas, et un petit mug de Benco me remet bien vite d'aplomb, sur les rails, dans le sens de la marche. Aux gens qui se sentent si mal dans leur peau et dans leur monde, on devrait interdire d'infliger aux autres et d'une façon si sournoise un aperçu morbide de leur dépression totale, sans rémission possible.

Revenons à présent au rapprochement annoncé. Tony Kaye partage avec Maïwenn un même manque de pudeur et de subtilité. Que dis-je, ils ont comme particularité commune une extrême vulgarité, une lourdeur à toute épreuve et sans égale. Ce sont deux marteau-piqueurs humains, prêts à vous enfoncer n'importe quoi dans le crâne. Si j'étais le dictateur fasciste d'un pays mis à ma botte et qu'il me fallait choisir deux réalisateurs afin de mettre en image des clips de propagande efficaces pour embrigader les esprits, je choisirais sans hésitation cette paire diabolique, ces jumeaux d'épouvante que sont Maïwenn et Tony. Ils feraient un travail excellent, probant, j'en suis persuadé ! Si leurs deux films s'affrontaient aux jeux olympiques de la connerie, j'aurais bien dû mal à décerner la médaille d'or et le combat ferait rage jusqu'à la dernière seconde. Mais comme je suis un peu chauvin, je finirais forcément par l'attribuer à Polisse. Cocorico ! La française Maïwenn devance tout de même assez largement l'américain Tony Kaye en termes de vulgarité, de racolage et de bassesse. Mais qu'elle se méfie, l'autre doit prendre des produits dopants et apprendre auprès des plus grands, car sans bruit, dans son coin, il a produit une performance assez étonnante qui aurait d'ailleurs mérité une couverture médiatique au moins comparable à celle qui fut en son temps réservée à l'exploit de Maïwenn. Quoique, American History X promettait déjà de belles choses... Mais lâchons les JO et revenons à ces deux films. Dans les deux cas, on louche très fort vers le documentaire, le témoignage filmé, on s'amuse des frontières entre fiction et réalité, on en fait fi et l'on joue dangereusement avec, pour mieux captiver le spectateur, forcément tétanisé face à un tel spectacle ne proposant aucune mise à distance et toujours mené à un rythme tel qu'il ne permet même pas de reprendre son souffle entre deux scènes chocs où les larmes, les cris, les coups, bref, la violence, éclate à l'écran sans retenue. J'avais l'estomac retourné devant ces films, mais les yeux rivés sur mon écran, comme ensorcelé par un gourou employant les plus abjectes techniques d'hypnose. Dans Detachment, Adrien Brody apparaît régulièrement filmé en gros plan, éclairé comme le sont les intervenants dans ces émissions télévisées racoleuses telles que Faites entrer l'accusé, lors de brefs intermèdes où il se livre, seul face à la caméra. L'acteur, à son meilleur, témoigne alors de son expérience dans ce maudit lycée où il a assuré le remplacement d'un prof de littérature. Il fait toujours preuve d'un petit humour décalé, détaché, désespéré, tournant en dérision la situation qu'il a vécue, comme pour mieux la supporter à nouveau quand il nous en reparle. Ces petits apartés calamiteux enrobent le film de la plus abominable manière. A ce niveau-là, ce n'est même pas une faute de goût, puisque le film n'est que ça, c'est une véritable agression de l'ensemble de nos sens et de notre intellect par un homme irresponsable, à tenir éloigné des plateaux à tout jamais, j'ai nommé Tony Kaye.

Plus évident encore, Polisse et Detachment sont tristement à rapprocher pour leurs sujets ultra faciles et leur penchant à utiliser le malheur des plus jeunes, ici les adolescents en crise, comme un prétexte non pas, cette fois-ci, pour se grandir et s'auto-congratuler, bien que cela soit aussi parfois le cas, mais avant tout pour se morfondre et se complaire dans un pessimisme total, sans échappatoire possible, si écrasant qu'il perd toute espèce de crédibilité. En outre, les films de Tony et Maïwenn sont tous deux remplis de maladresses terribles qui les font atteindre des sommets de ridicule, lors de scènes grandiloquentes qui se croient pourtant tout à fait géniales et extrêmement émouvantes. Deux suicides abjects viennent clore ainsi chacun des films et en sont les meilleures illustrations. Ils sont censés serrer les gorges des spectateurs, leur rabattre le clapet et leur nouer l'intestin une bonne fois pour toutes, comme si tout ce qui précédait n'avait pas suffi. Seul un éclat de rire pourra alors sortir de la bouche des plus détachés, des plus imperméables à tant d'horreur et d'ignominie. Pour ma part, c'est un gros soupir d'exaspération qui s'est emparé de moi lors de la conclusion risible de ce climax lamentable, où une lycéenne obèse, reine de la mise en scène, s'empoisonne devant tout le monde lors du goûter de fin d'année en ingurgitant un muffin décoré d'un smiley tristounet (je n'invente rien !). Des moments qui se veulent un peu légers ponctuent également les deux films. Vous vous rappelez que la musique de L'Île aux enfants ouvrait le film de Maïwenn. Au même moment, nous avons ici droit à un générique animé tout à fait insupportable, entrant en décalage avec le ton globalement ultra plombant et austère du film. Ce n'est pas tout, un petit interlude grotesque nous montre aussi la vie rêvée d'un personnage détestable (mais que nous ne détestons pas moins que son créateur !) de professeur haï de tous : des petits vignettes colorées nous le montrent rentrer chez lui triomphant et se faire cajoler par sa femme, pleine d'amour. Là encore, on fait dans la légèreté, l'ironie habile. On est simplement atterré de voir ça. Maïwenn ne faisait pas preuve de beaucoup plus de finesse lorsqu'elle tentait de décontracter faussement l'atmosphère en tournoyant un quart d'heure autour de Joey Starr sur le dancefloor ou en faisant se trémousser les enfants d'une communauté Rom sur un air techno.

Aussi, les deux films sont autant de prétextes pour quelques performances d'acteurs de haut vol. Nous avons évidemment droit à une scène où Adrien Brody parvient avec brio à captiver toute sa classe, pourtant constituée d'éléments très difficiles qui, lors du premier cours, n'hésitèrent pas à insulter sa maman en le regardant droit dans les yeux, se tenant debout face à lui, à quelques centimètres - plein de courage et de sang froid, l'acteur trouvait alors l'occasion d'étaler toute sa répartie. Adrien Brody donne un cours réellement passionnant sur
La Chute de la Maison Usher, il réussit à intéresser tous les élèves, sans exception, à la nouvelle de Poe, en débitant les pires évidences avec le talent et l'aisance du plus efficace orateur. Tout le CV de Brody semble apparaître alors à l'écran. Les cours de théâtre qu'il suit assidument depuis le début de son adolescence sont d'un seul coup justifiés et mis en application face à nous. Le corps de l'acteur prend l'apparence d'une brochure pour l'Actor's Studio qui se déplierait maladroitement sous nos yeux, dans un bruit assourdissant de papier froissé. L'Oscar n'est pas loin. Une petite nomination aurait été la moindre des choses si le film avait eu la chic idée de sortir pendant les fêtes de Noël, seule période où s'effectue la sélection pour cette grande compétition ridicule dont on a voulu nous faire avaler l'immense prestige l'an passé, quand
The Artist était sur le point de tout rafler. Il s'agit donc là d'une scène conçue pour placer l'acteur sur un piédestal, sans doute un vrai régal pour un comédien, à l'image des interludes-témoignages. Rappelons que le film de Maïwenn est également rempli de scènes d'engueulades ou de mises à nu qui doivent représenter du pain béni pour des comédiens dont on n'oublie jamais de saluer les performances. Adrien Brody, tout comme Marina Foïs et Karin Viard, a eu droit aux plus beaux compliments. Moi, devant ça, j'ai simplement envie de supplier Brody de retourner s'amuser dans des séries b minables où il peut faire le mariole en affrontant des
Predators à mains nues et empocher le pactole.

Adrien Brody n'est évidemment pas le seul à profiter de toutes ces belles opportunités. Lucy Liu, James Caan, Christina Hendricks et Marcy Gay Harden nous proposent chacun leur tour leurs petits numéros, comme des petits animaux de foire bien élevés, polis, rêvant déjà de leurs récompenses : un bon mot, un sucre ou une tape sur le flanc. A ce petit jeu pitoyable, il faut bien reconnaître que l'ancêtre James Caan s'en tire à merveille, il nous offre la scène la plus caustique du film lorsqu'il implore une lycéenne très légèrement vêtue de bien vouloir enfiler au moins un soutien-gorge. Bien sûr, on n'en voudra pas à l'acteur, lui qui nous a tant séduit à l'époque où il avait encore tous ses neurones pour choisir ses rôles. Lucy Liu est facilement la plus exaspérante, on ne croit à aucun de ses mots, bien que Marcy Gay Harden ne soit pas loin. A la différence de sa collègue aux yeux d'orientale, Marcy Gay Harden a le défaut de ne pas surprendre une seule seconde dans ce rôle de femme à bout de nerfs qu'elle a déjà endossé une demi-centaine de fois. Quant à la débutante Christina Hendricks, j'avoue qu'elle m'a d'abord assez agréablement surpris, se montrant notamment plus charmante que je ne l'avais jamais vue, elle qui est d'ordinaire si vulgaire (une vulgarité crasse dont Nicolas Winding Refn s'était d'ailleurs ouvertement moqué). Mais lors du dernier tiers du film, son personnage se met à agir de façon totalement invraisemblable et l'actrice paraît alors bien incapable de donner un peu de crédibilité aux situations lamentables dans lesquelles la pousse son réalisateur et scénariste. A sa décharge, je pense que strictement personne n'aurait pu y parvenir.

Je finirai cette critique en vous offrant un petit aperçu de ce que nous propose ce film. Assez tôt, Adrien Brody prend pitié pour une jeune prostituée, largement mineure, qu'il croise régulièrement sur le trajet qui le mène à son appartement. Après l'avoir secouée en la traitant de tous les noms, sans succès, il finit par sympathiser avec elle et lui permet même de vivre quelques temps sous son toit. La jeune fille a l'entre-jambe constellée de cicatrices plus ou moins fraîches, des blessures bien moches. A-t-elle déjà été violée au couteau par quelque détraqué ? C'est ce que l'on peut aisément s'imaginer à la vue des gros plans inqualifiables de Tony Kaye. Le premier jour passé à l'appartement de Brody suite à son aimable invitation, la jeune catin le consacre très intelligemment à recevoir des clients. On la devine en train de tailler des pipes sur le canapé de Brody, pour se faire un peu d'argent. Naturellement, Brody n'est pas vraiment jouasse quand il rentre du boulot et la découvre à quatre pattes dans son salon. Vous imaginez un peu la scène ? Detachment n'est qu'une succession de scènes désarmantes de ce genre-là. Et je préfère ne pas vous parler de toutes celles où Brody, dont la vie n'est décidément pas rose, se rend à l'hôpital, au chevet de son père gravement malade, en phase terminale d'un cancer, dans un état de décrépitude psychologique tel qu'il lui fait affirmer des choses très blessantes au sujet de feu son épouse, la mère de Brody, disparue alors qu'il n'était qu'enfant dans d'affreuses circonstances (alcoolique, elle s'est suicidée, et nous revoyons ce moment en Super 8, peut-être pour qu'il soit plus joli, que sais-je...).

Tony Kaye, je ne t'apprécie pas, et je n'ai pas beaucoup aimé ton film, mais j'espère sincèrement que tu es plus gâté au quotidien que ne le laisse supposer ton odieux rejeton. Si j'avais quelques euros à jeter par la fenêtre, j'adorerais t'offrir une smartbox pour te donner la possibilité de passer un beau séjour dans une contrée paisible, éloignée de ta morne vie new-yorkaise, à la seule condition que tu n'emportes pas de caméra dans tes bagages. Cela te ferait certainement du bien.
Detachment de Tony Kaye avec Adrien Brody, Lucy Liu, Christina Hendricks, James Caan et Marcy Gay Harden (2012)
 Après avoir réalisé entre autres les très sympathiques Peindre ou faire l'amour et Voyage aux Pyrénées, deux films réunis par leur modestie et par la simplicité de leurs moyens, et avant L'Amour est un crime parfait, film ô combien imparfait, les frères Larrieu ont sorti il y a douze ans ce film apocalyptique dont le titre annonçait un spectacle de grande ampleur, et qui racontait effectivement la fin du monde avec son lot de massacres, de mouvements de foule, d'errances et de matchs de volley-ball. On retrouvait au casting un habitué des Larrieu, Mathieu Amalric, ici manchot, et, déjà, Karin Viard, ainsi que Catherine Frot et d'autres gens. En sortant de la salle à l'époque, je m'attendais presque à trouver les rues désertes et jonchées de cadavres. Il semblait s'être passé tant de temps – une éternité – entre le moment où j'étais entré dans le ciné et celui où j'en ressortais que je n'aurais pas été surpris de découvrir que le monde avait pris fin entre-temps, non des suites d'un cataclysme aux causes multiples, comme dans le film, juste mort de vieillesse.
Après avoir réalisé entre autres les très sympathiques Peindre ou faire l'amour et Voyage aux Pyrénées, deux films réunis par leur modestie et par la simplicité de leurs moyens, et avant L'Amour est un crime parfait, film ô combien imparfait, les frères Larrieu ont sorti il y a douze ans ce film apocalyptique dont le titre annonçait un spectacle de grande ampleur, et qui racontait effectivement la fin du monde avec son lot de massacres, de mouvements de foule, d'errances et de matchs de volley-ball. On retrouvait au casting un habitué des Larrieu, Mathieu Amalric, ici manchot, et, déjà, Karin Viard, ainsi que Catherine Frot et d'autres gens. En sortant de la salle à l'époque, je m'attendais presque à trouver les rues désertes et jonchées de cadavres. Il semblait s'être passé tant de temps – une éternité – entre le moment où j'étais entré dans le ciné et celui où j'en ressortais que je n'aurais pas été surpris de découvrir que le monde avait pris fin entre-temps, non des suites d'un cataclysme aux causes multiples, comme dans le film, juste mort de vieillesse.