
Une ouverture idéale d'abord, avec L'Ombre des femmes de Philippe Garrel. Prolongement assez évident de son précédent film La Jalousie, et réussite aussi limpide que Les Amants réguliers. Sur une trame aussi simple qu'à son habitude (Pierre et Manon forment un couple de cinéastes solide mais fatigué ; Pierre rencontre Elisabeth qui devient sa maîtresse, et par laquelle il apprend que Manon a elle aussi un amant), Garrel touche à l'essence du sentiment amoureux, dans un mélange constant et bouleversant de douceur et de douleur qui irradie chaque scène. La mise en scène, d'apparence simple et très sèche, associée à la splendeur du noir et blanc de Renato Berta, est admirable. Et Garrel tire le meilleur de son casting étonnant : les revenants Stanislas Merhar (parfait en homme trompant et trompé, taiseux et cruel) et Clotilde Courau (dont émane un bouleversant mélange de force et de souffrance), et la découverte Lena Paugam, beauté discrète mais intérieurement bouillonnante. La relation entre Pierre et Manon est hantée par le mensonge, intelligemment et discrètement symbolisé par ce vieux résistant à qui le couple consacre un film, et qui s'avèrera ne pas être celui qu'il prétend. Un film d'une grande cruauté et d'une immense beauté.

Autre réussite indiscutable, dès le deuxième jour de la Quinzaine : Trois souvenirs de ma jeunesse d'Arnaud Desplechin, prequel explicite de Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle), lors duquel Mathieu Amalric reprend brièvement le rôle d'un Paul Dedalus quarantenaire se replongeant dans les souvenirs de son enfance, son adolescence et sa vie de tout jeune homme. Les deux premiers souvenirs sont très courts : le premier voit Paul enfant subir les crises de folie de sa mère, et quitter la maison familiale ; le second est un étonnant récit d'espionnage où Paul, en voyage scolaire en URSS, est missionné pour "offrir" son identité à un jeune juif cherchant à quitter le pays pour Israël ; puis vient le troisième, qui occupe à lui seul près de deux heures de film, chronique de la rencontre et de la passion entre Paul et Esther (dont le rôle était tenu par Emmanuelle Devos dans Comment je me suis disputé...). La singularité et la virtuosité de l'écriture de Desplechin trouvent dans la bouche de ces jeunes gens une vigueur nouvelle, en particulier dans celle du jeune Quentin Dolmaire, jeune comédien sorti de nulle part, authentique révélation, boule de nerfs et de flegme mêlés, capable des fulgurances expressives et verbales les plus étonnantes (Amalric bien sûr, mais aussi Léaud ne sont pas loin). Comme Garrel mais d'une façon évidemment très différente, Desplechin s'approche au plus près de la sève des relations hommes/femmes, de ce qu'elles peuvent générer d'exaltation, de folie et de souffrance. Sa narration et sa mise en scène sont d'une grande liberté et d'une folle inventivité, et ce film son plus beau depuis longtemps.
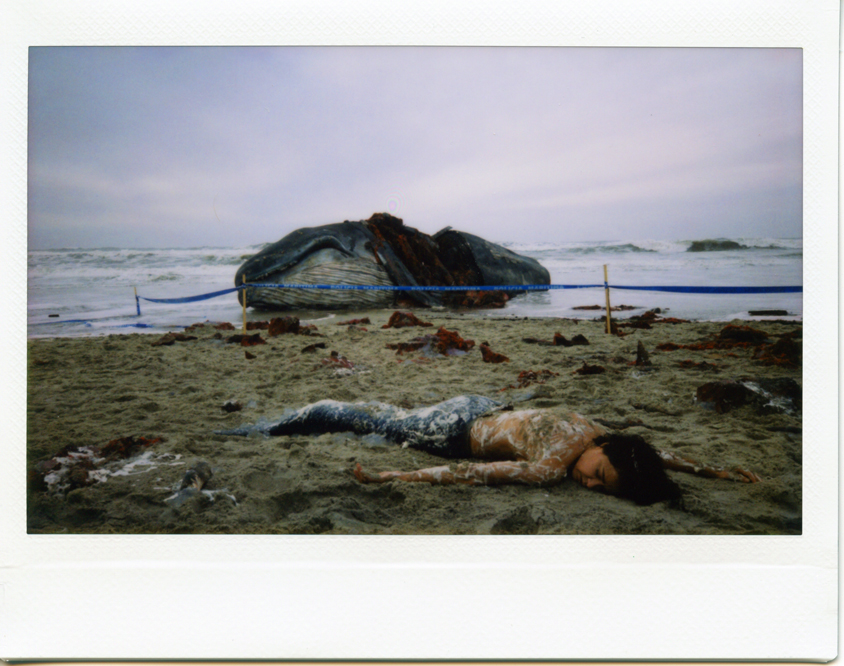
Je n'ai pu voir que le premier volume des Mille et une nuits de Miguel Gomes, projeté le 3ème jour. Une expérience folle, stimulante, parfois agaçante, constamment surprenante. L'ambition qui émane de ce film de 6 heures (découpé en 3 volumes de 2 heures) est grandiose et inédite : s'attaquer à la situation désastreuse du Portugal d'aujourd'hui par (presque) tous les moyens qu'offre le cinéma. La fiction dramatique, le documentaire, le conte, l'autofiction, l'interview, bien d'autres choses encore, et parfois plusieurs de ces choses mélangées (et encore, je n'ai pas vu les deux volumes suivants). Autrement dit, escalader l'Everest par toutes ses faces, simultanément. Bien sûr, on ne peut pas se lancer dans une telle entreprise seul, et Gomes aime beaucoup rappeler que cette œuvre est le fruit d'un travail collectif (des journalistes furent chargés de collecter pendant plusieurs mois toutes sortes d'informations et de faits divers à travers le pays, que Gomes et sa scénariste ont ensuite sélectionnés et plus ou moins remodelés pour les intégrer au film). On peut légitimement parfois s'agacer ou décrocher de ce joyeux foutoir et de l'impudence de son auteur, mais il en émane une telle énergie, une telle acuité et une telle drôlerie qu'il finit par tout emporter. Miguel Gomes confirme qu'il est bien un des jeunes cinéastes contemporains les plus aventureux en faisant littéralement exploser tous les schémas, et en livrant une vision à la fois impertinente, sombre mais non dénuée d'espoir de la situation de son pays, de l'Europe, du monde. On redécouvrira ce premier volet et les deux suivants avec bonheur en salles cet été.

Waintrop a visiblement programmé à dessein ces trois immenses films sur les cinq premiers jours du festival, pour frapper un grand coup. Quelques petites perles ont par ailleurs émaillé sa sélection, notamment le premier film de la réalisatrice sino-américaine Chloé Zhao, Les Chansons que mes frères m'ont apprises. Situé dans une réserve indienne du Dakota du sud rongée par la pauvreté et l'alcoolisme, le film suit deux personnages principaux, un garçon de 19 ans et sa petite sœur de 11 ans, livrés à eux-mêmes par une mère volage et seule, et par un père qui leur a offert 27 demi-frères et sœurs de 9 mères différentes (!), et qui vient de mourir dans l'incendie de sa maison. Le film cumule plusieurs handicaps de prime abord, en premier lieu la lourdeur de son sujet et l'influence stylistique très visible de Terrence Malick. Mais débarrassé des lourdes prétentions métaphysiques (et des voix off impossibles) des derniers films du vieux maître, et délesté de tout pathos, le film émeut et offre beaucoup de scènes très réussies et de personnages aussi beaux que leurs jeunes comédiens. Un petit film fragile mais très séduisant.

Plus inégal, El Abrazo de la Serpiente du colombien Ciro Guerra plonge quant à lui au cœur de la forêt amazonienne, faisant des aller-retours entre deux époques sur les traces de deux explorateurs occidentaux à la recherche d'une plante rare et miraculeuse. Ils se confrontent à l'hostilité de la nature, aux indigènes locaux, se frottent aux pratiques chamaniques, mais surtout à la destruction de tout ce fragile équilibre par l'exploitation grandissante de la forêt. Le film est loin d'être exempt de défauts (quelques lourdeurs et scènes complètement ratées), mais aussi de sacrées audaces, telle cette explosion psychédélique absolument inattendue et très belle à la fin du film.
Seule vraie déception parmi ce que j'ai pu voir à la Quinzaine, Green Room de Jeremy Saulnier, qui après Blue Ruin livre un survival indéniablement efficace (la salle était très réactive) mais aussi assez bête par sa violence grotesque et son humour bas du front.

La sélection de la Semaine de la critique était bien sûr moins excitante sur le papier. Ayant raté le paraît-il séduisant premier film de Louis Garrel (Les Deux amis), je n'ai pu y voir que Ni le ciel, ni la terre, le premier long métrage de Clément Cogitore, jeune cinéaste très remarqué pour ses courts, et qui confirme ici un talent extrêmement prometteur. Ni le ciel, ni la terre raconte l'histoire d'une troupe de soldats français (commandée par un Jérémie Renier convaincant) postée à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, près d'un petit village et d'une position taliban. Un jour, alors que leur retrait est imminent, certains d'entre eux se mettent à disparaître mystérieusement. Le film trouve un intéressant équilibre entre une puissance d'incarnation très physique (ce n'est pas un film de guerre, mais il en émane beaucoup de violence à peine contenue et une très belle façon de filmer les corps et leur tension) et une dimension métaphysique pleine de mystère et de questions non résolues. Dans les deux cas, le film fait preuve de beaucoup d'humanité et d'intelligence.

Venons-en maintenant à la sélection officielle, et d'abord à son "antichambre", Un certain regard, où se sont vus rétrogradés deux immenses cinéastes asiatiques. Pour l'un d'entre eux c'est une surprise d'autant plus grande qu'il a obtenu la Palme d'or il y a quelques années (c'est un phénomène rare, dont de mémoire le seul équivalent est la présence du Restless de Gus van Sant dans cette section, quelques années après la Palme d'Elephant). Avec Cemetary of Splendour, Apichatpong Weerasethakul ne rate pas son retour. Dans un petit hôpital construit sur les ruines d'un cimetière, des soldats sont plongés dans un sommeil profond. Autour d'eux, deux femmes d'âge différents, dont une jeune femme capable de communiquer avec l'âme des morts et des soldats endormis. Un jour, l'un d'eux se réveille. Constamment pris entre la réalité et les songes, la vie et la mort, le film provoque une sidération permanente, purement cinématographique, un immense bien-être cotonneux parfois percé de violentes fulgurances, dont je ne veux évidemment dévoiler aucune ici pour en préserver la surprise (je vous avertis juste d'une scène prodigieuse de générosité, de trouble charnel et de monstruosité mêlés à la fin du film). Pour reprendre approximativement une formule entendue à Cannes, c'est le "film-cure" du festival, celui qui par sa beauté guérit de tout ce qu'on voit de laid, là-bas et ailleurs.

Il est frappant de constater que Kiyoshi Kurosawa s'intéresse lui aussi, dans Vers l'autre rive, à la relation entre le monde des morts et celui des vivants (ce n'est pas la première fois en ce qui le concerne non plus), pour un résultat évidemment très différent mais néanmoins passionnant. Un homme mort noyé trois ans auparavant réapparaît dans la vie de sa femme. Cette dernière en est évidemment bouleversée, mais n'en semble pas étonnée outre-mesure (il faut la voir et entendre dire, quand elle voit son mari apparaître dans un coin de son salon : "Oh, tu es là", avec une désarmante simplicité qui suscite bien plus d'émotion que si elle avait éclaté en sanglots). Ensemble, ils entreprennent un voyage à travers le Japon, dans une région où le mari semble avoir un temps vécu pendant son absence. Un film apaisé, à la mise en scène discrètement majestueuse, et d'une grande intensité émotionnelle.

Il est probable que la relégation de ces deux maîtres à Un certain regard s'explique par l'extraordinaire densité des prétendants asiatiques cette année. Trois sont en compétition. Si j'ai raté le Kore-Eda et le Hou Hsiao-Hsien (tièdement accueillis semble-t-il), j'ai pu voir le nouveau film de Jia Zhangke, deux ans après le fantastique A Touch of Sin. Si ce dernier embrassait l'histoire contemporaine de la Chine par le prisme de la violence, Mountains May Depart est un pur mélodrame, très ample lui aussi, puisqu'il se situe sur trois époques (1999, 2014, 2025), deux continents, et s'attache à deux générations de personnages. Si le film souffre d'une troisième partie moins convaincante, et de quelques lourdeurs symboliques assez étonnantes (tel ce choix d'appeler un des personnages "Dollar"), il n'en demeure pas moins admirable par l'incroyable inventivité de sa mise en scène, par l'égale finesse avec laquelle il traite le sentiment amoureux et la critique économique et sociale, et par l'émotion qui naît de sa peinture d'un personnage féminin passionnant, interprété par Zhao Tao, et son fascinant visage constamment rieur et néanmoins empreint de douleur. Le travail de Jia Zhangke sur le son est aussi particulièrement marquant. On se souviendra longtemps de ces basses vibrantes qui ont fait trembler le Grand Théâtre Lumière, et surtout de ces deux scènes musicales, la première et la dernière du film, qui ont fait du Go West des Pet Shop Boys l'étonnante chanson du festival.

Mon deuxième favori (personnel) de la compétition est Mia Madre de Nanni Moretti, où mélodrame et comédie de succèdent, se superposent par moments. Moretti s'y construit un alter ego féminin, Margherita (Margherita Buy), réalisatrice qui tourne un film social (visiblement médiocre) sur une usine en grève. La patron de l'usine est joué par un acteur américain égocentrique et excentrique (John Turturro, toujours à la limite du cabotinage, souvent génial). Parallèlement, la mère de Margherita est en train de mourir. Dans cette épreuve Margherita est épaulée par sa fille adolescente et par son frère (incarné par un Moretti parfait de sobriété), qui décide lui-même de quitter son travail pour s'occuper de sa mère. Mia Madre est un film inquiet et passionnant sur la confusion de notre époque, à de multiples niveaux (social, culturel, éducatif, artistique...), et aussi l'émouvant portrait d'une femme entre deux âges et de ses difficiles rapports aux autres (collaborateurs, amoureux, famille). La mise en scène de Moretti est d'une sobre élégance mais réserve aussi des surprises étonnantes, en particulier quand il se frotte au rêve. Il y a peut-être finalement là une tendance forte dans les films les plus intéressants du festival : presque tous contiennent une forte dimension onirique et une volonté forte de représenter les rêves, les songes ou l'au-delà.
C'est malheureusement aussi le cas dans certains films ratés. Mais le plus malheureux, c'est que l'un d'eux soit l’œuvre d'un réalisateur aussi adoré que Gus Van Sant. La Forêt des songes a été (presque) unanimement rejeté par les festivaliers, et il est difficile de les contredire. Un mélo empesé et désincarné, souffrant d'un scénario souvent grotesque (un homme décide d'aller se suicider dans une forêt au pied du Mont Fuji, où il rencontre un autre homme, japonais, qui y a lui renoncé un peu tard. Au gré de réguliers flash-backs, on apprend ce qui a conduit notre héros à en arriver là) que Van Sant ne transcende qu'à de rares occasions dans la première moitié du film (la deuxième heure est un calvaire total). Ajoutons à ça une musique mainstream omniprésente et la prestation rapidement insupportable de Matthew McConaughey, qui va devoir faire attention à ne pas rapidement perdre tout le beau crédit dont il jouit depuis son come-back. N'en jetons plus, nous avons tellement admiré le travail de Gus Van Sant, nous continuons à croire en lui en plaidant l'accident de parcours.

Voilà pour les "grands maîtres" de la compétition. Il y avait aussi un premier film, Le Fils de Saul du hongrois Laszlo Nemes, et pour beaucoup ce fut un choc. Le film se situe intégralement à Auschwitz, et ne quitte jamais le visage de son personnage principal, Saul Aüslander ("l'étranger"), détenu juif faisant partie d'un sonderkommando, sélectionné par les nazis pour mener ses semblables à la chambre à gaz et "nettoyer" celle-ci de leurs cadavres. Un jour, Saul voit un enfant ayant survécu au gazage, qu'un médecin ausculte avant de l'achever en l'étouffant. Saul le reconnaît comme son fils, et se met dès lors en tête de récupérer son cadavre et de trouver un rabbin pour lui offrir un enterrement en-dehors du camp. La mise en scène, dans un format 1.33 surprenant, est faite de plan-séquences très longs, de gros plans permanents sur le visage de Saul, tout le reste étant flou ou relégué dans le hors-champ (énorme travail sur le son, infernal). Tout ça est impressionnant de maîtrise, beaucoup trop. Le film est absolument irrespirable, et il en émane rapidement un sentiment de complaisance et un manque de générosité étouffant, même quand les grilles du camp sont finalement franchies, en bout de film. Laszlo Nemes témoigne d'un talent formel indéniable, mais on espère que dans le futur il en fera autre chose qu'un "film-choc" comme le festival en raffole (il y a fort à parier qu'il sera en bonne place au palmarès).

Autre film très sérieux dans un tout autre registre formel : La Loi du marché de Stéphane Brizé, dans lequel Vincent Lindon incarne Thierry, chômeur depuis 15 mois, enchaînant les entretiens à Pôle emploi, les formations infructueuses, les rendez-vous blessants à la banque. Il finit par accepter un poste d'agent de sécurité dans une grande surface. Lindon est le seul comédien professionnel du film, écrit et tourné à toute vitesse. Il y est formidable d'intensité, et le principe du film le confrontant exclusivement à des comédiens amateurs, pour la plupart dans leurs propres rôles, fonctionne à merveille. Le film n'est évidemment pas exempt de tout reproche : la mise en scène de Brizé, en apparence très minimaliste, peut paraître fonctionnelle et systématique, voire assez laide. Il s'attache surtout à saisir les choses sur le vif, caméra à l'épaule, en plan-séquences (même si la plupart sont discrètement remontées). La surenchère de situations négatives (on dirait qu'il a synthétisé en 1h25 toutes les choses terribles auxquelles peut être confronté un homme en difficulté) est facilement assimilable à du misérabilisme. L'ensemble est néanmoins d'une puissance et d'une acuité assez incroyables sur ce qu'est la violence du monde du travail d'aujourd'hui. Et si ce cinéma manque indéniablement d'ampleur et d'inventivité, Brizé fait partie de ses meilleurs représentants en France. Et il est assez satisfaisant de constater (le film est sorti cette semaine) qu'un large public y accède, donnant tort à tous les commerçants du cinéma décrétant que le public n'aspire qu'à se divertir en s'évadant de son quotidien.

Plus discutable encore est mon ressenti à propos de Marguerite et Julien, le nouveau film de Valérie Donzelli, dont le hit La Guerre est déclarée avait suscité chez moi la même aversion que chez les créateurs de ce blog (et auprès de qui ce paragraphe risque me coûter très cher pour longtemps). A de rares exceptions près, Marguerite et Julien a été largement rejeté à Cannes. A mon grand étonnement, le film m'a emporté. A partir d'un scénario de Jean Gruault écrit pour François Truffaut dans les années 70, il conte l'histoire d'un frère et d'une sœur (Jérémie Elkaïm et Anaïs Demoustier), dans une époque lointaine, éperdument amoureux l'un de l'autre depuis l'enfance, longuement séparés, se retrouvant jeunes adultes, bien décidés à vivre leur amour en dépit de tous les obstacles. Bien sûr, le film est loin d'être parfait. Donzelli fait feu de tout bois, ose l'emphase romanesque et les tentatives formelles les plus débridées, et parfois ça ne fonctionne pas et vire au ridicule. Mais le film a pour lui un souffle indéniable, une foi réjouissante dans le pouvoir d'évocation du cinéma et la croyance du spectateur (effets spéciaux désuets, anachronisme permanent - dans les costumes mélangeant plusieurs époques, ou quand un hélicoptère fait soudain irruption dans le champ), et une interprétation convaincante. Ce n'est pas très étonnant concernant Anaïs Demoustier, plus belle et intense que jamais, ça l'est plus pour Jérémie Elkaïm, étonnant de sobriété. Ils donnent chair de belle manière à ce couple étrange et inadapté, dans un film à la charge érotique puissante et perturbante.

Ps : finissons sur une note plus consensuelle. A Cannes Classics, on a pu voir le documentaire de Kent Jones intitulé Hitchcock/Truffaut, qui sera bientôt diffusé sur Arte. Il s'attache à décrire la relation entre les deux cinéastes, et la genèse d'un des plus grands livres de cinéma qui en a résulté, en s'appuyant sur une forte documentation et sur les témoignages souvent très intéressants de cinéastes invités (Scorsese, Fincher, Bogdanovich, Assayas, Desplechin, Kurosawa...). Mais le film dévie assez vite de son programme initial pour entrer (et faire entrer les cinéastes sus-cités) de façon profonde et passionnée dans l’œuvre d'Hitchcock, dans leur rapport intime à celle-ci, et plus particulièrement à deux films, Psycho et Vertigo. Un documentaire passionnant, et très salutaire au milieu du tunnel de films contemporains vus à Cannes.



























