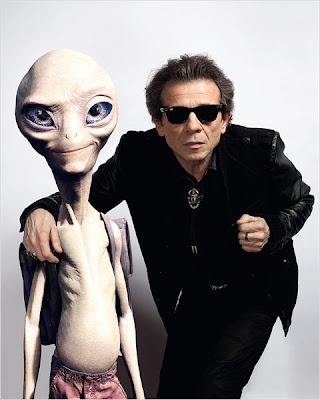Emmanuel Mouret revient à son violon d’Ingres pour notre plus grand plaisir.
Caprice est un retour à la comédie, à la légèreté, aux histoires d’amours complexes sans oublier d’être vives et variées, mais aussi à ce qui fait le sel du cinéma d'Emmanuel Mouret : les fantasmes. Toutes ces choses, le cinéaste les avait plus ou moins délaissées dans son précédent film, le mélodrame
Une Autre vie, qui portait bien son nom puisqu’il était totalement
autre dans la filmographie de son auteur. La tentative de changer de registre était louable mais, disons-le franchement, ce n’est pas un hasard si ce titre restera, jusqu’à nouvel ordre, le seul Mouret post-2007 passé sous silence sur nos pages. Revenons donc à ce qui nous importe,
Caprice, dans lequel Mouret réapprend à céder à tous les siens.
Le cinéma d’Emmanuel Mouret a toujours été, nous semble-t-il, et depuis
Laissons Lucie faire !, son premier coup d'essai, une question de rêves et et de fantasmes concrétisés. Il y a quatre ans de cela, dans un petit éloge du très plaisant
Fais-moi plaisir !, j’avais tenté une rapide énumération des fantasmes cinématographiquement assouvis par le cinéaste dans l’ensemble de ses films (à l’exception de
Vénus et Fleur, que je n’avais sans doute pas encore vu à l’époque). Pour Mouret, le plaisir du cinéma semble passer par la mise en actes et en scène de la multitude de ses propres désirs, qui sont aussi, très souvent, les nôtres, ou finissent par le devenir. Dans
Caprice, le cinéaste tire l’une des cartes maîtresses de son jeu des fantasmes puisque le film pose, si l'on veut, la question ultime : peut-on vivre avec la personne de ses rêves ?

Mais tout ou presque dans le film tient, d'une manière ou d'une autre, d’un monde rêvé. Dès la première séquence. Clément, le personnage d’instituteur incarné par Mouret lui-même, est assis sur un banc avec son fils, dans un jardin public, et fait une pause dans sa lecture pour tâcher de sortir son gamin de la sienne. L’enfant est absorbé dans un livre depuis le matin et refuse toute autre activité a priori plus séduisante à son âge (jouer dans le parc, aller au cinéma, se laisser accaparer par un jeu vidéo sur téléphone, etc.) que lui propose son père. Quittant le parc, père et fils ne quittent pas pour autant leur livre des yeux, marchant côte à côte tout en lisant, en parfaite harmonie. Mieux, le gamin sera aux anges quand la future nouvelle compagne de son père lui offrira l’intégrale de Victor Hugo dans la Pléiade pour son anniversaire. Ce qui relève du rêve pour la plupart des parents (mais je généralise peut-être ici), est, dans
Caprice, réalité. Mais le rêve réalisé et maintenu à son plus vif degré dans la durée est-il vivable ? Le père, l’air inquiet, suggère lui-même à son fiston toutes sortes d’alternatives, pour le sortir de son état d’enfant prodige dont la soif de culture touche à la perfection, pour le sortir aussi de la fiction qui l'enveloppe.

Paradoxalement, c’est le père, Clément, qui se fait rattraper par la fiction quand une célèbre actrice de théâtre, son idole absolue, Alicia (Virigine Efira), surgit de son cadre : l’affiche, la scène, le texte, le personnage ; et vient le tirer de l’école où il enseigne pour le faire entrer chez elle, où il la découvre endormie sur son sofa, comme l’héroïne du roman qu’il est en train de lire, « La femme qui dort ». Elle est d’une beauté parfaite, image d’Épinal si sublime que Clément fait des pieds et des mains pour empêcher la jeune femme endormie, tenant à bout de doigt une tasse de café, de se réveiller en faisant tomber ladite tasse, risquant de laisser une tache noire sur le tapis blanc immaculé du salon. Il faut éviter la fausse note qui viendrait briser le mythe. C'est d'ailleurs en renversant un verre de vin sur Alicia que Clément la rend finalement accessible, et bientôt les deux personnages filent le parfait amour. Mais on sait, depuis l’introduction, où Clément voulait sortir son fils de la fiction et rompre le charme d'une situation trop paisible, qu'il y a chez lui la volonté de ne pas trop longtemps laisser s’installer un confort, de vouloir parfois fermer le livre pour gambader, en tout cas se laisser détourner de son chemin, sans trop résister, quand quelqu’un ou quelque chose d’imprévu, et de potentiellement périlleux, se présente. Aussi, après une scène obligée des comédies romantiques, la fameuse séquence heureuse où la musique surplombe les dialogues et qui monte, bout à bout, de petits instants de bonheur partagé, séquence qui fait plus sens que jamais ici, puisqu’elle vient dénoncer ce qu’elle incarne, une idylle de roman-photo chargée de tous ses chromos, après elle donc, et presque sans transition, déboule Caprice (Anaïs Demoustier), venue ouvrir une brèche dans la toile.

Mais parce qu’il est un cinéaste du plaisir et du fantasme, les comédies de Mouret ne tournent jamais au vinaigre, ne deviennent pas des drames (quand bien même elles contiennent
du drame). Tout ce qui vient enrayer un bonheur parfait, né de l’actualisation d’un rêve (le petit professeur sans histoire rencontrant par hasard l’actrice qu’il idolâtre depuis toujours, dînant avec elle et devenant aussitôt son fiancé, le tout sans la moindre difficulté, ses gaffes commises au restaurant ne faisant qu’ajouter à son charme aux yeux de la belle blonde), est comme accueilli de bonne grâce par le malheureux. Clément, grand dadais maladroit, se laisse toujours embobiner, retarder, dérouter par ceux qu'il croise. Et les personnages dont il se laisse détourner ne font pas plus de scandale que lui (Alicia étant plus désolée qu’enragée par l’arrivée de Caprice, après que Clément lui a révélé le pot aux roses, sans traîner, sans tricher). Chaque accroc, au lieu d’accoucher d’un pénible sac de nœuds (Mouret refuse toujours le vaudeville idiot qui lui tend les bras), conduit presque invariablement Clément vers une autre tentation, un autre fantasme, un autre rêve, un autre possible, incarné par Caprice, fille jeune, libre, qui apparaît comme la promesse d’un autre avenir quand elle joue sa pièce de science-fiction devant Clément dans l’une des plus belles scènes du film.

Et le rêve, ou devrait-on dire l'utopie (pas étonnant, au passage, pour un cinéaste du rêve mêlé de fantasme incarnant un personnage incapable de choisir entre deux amours, que l'idéal utopique représenté dans cette pièce de science-fiction évoque l'amour du futur comme autant d'
intersections), n'est pas étrangère à la relation qui se tisse entre Caprice et Clément, la jeune femme étant aux petits soins avec lui, toujours présente quand il en a besoin, comme par miracle (sauf que la question de savoir si l'on peut partager la vie de celui dont on rêve se posera désormais à elle - elle se pose en vérité à pratiquement chaque personnage du film, même secondaire, comme le directeur du théâtre ou l'auteur de la pièce de science-fiction). Caprice n’est pas, contrairement à ce qu’elle prétend à un moment, l’incarnation du seul réel là où Alicia serait un rêve abstrait. Elle ne cesse de dire « C’était écrit non ? », à propos de ses rencontres fortuites, parfois totalement improbables, avec Clément. La dernière trace qu’elle laissera sera d’ailleurs écrite, et idéale, avant de disparaître comme un songe lointain.

On pourrait faire quelques reproches à ce film. D’abord celui d’introduire, en la personne de Caprice, un personnage parfois agaçant, limite irritant, ce dont le cinéma de Mouret est presque toujours et fort heureusement soulagé. Mais les talents d'Anaïs Demoustier, et
l'art d'aimer ses personnages déployé comme toujours par Mouret, rendent finalement aimable la demoiselle éponyme. Ensuite celui de passer un peu vite sur l’instant pourtant fatidique où Clément se laisse embrasser par Caprice, au risque de compromettre l’implication d’un spectateur trahi par le personnage. Mais, au final, ce saut étonnant dans le scénario contribue à l’impression de suivre un homme innocent que ses désirs mènent par le bout du nez et qui ne résiste pas au plaisir d’être aimé. Clément est à ce titre une sorte de précipité du cinéma de Mouret. En outre, cette précipitation n’entache en rien un film d’une finesse et d’une élégance propres à son auteur. L’écriture, la mise en scène, le jeu, tout là-dedans est subtil, précis, émouvant et drôle. Car le film est très drôle, et Mouret acteur n’y est pas pour rien, une fois de plus. Rares sont, quand on y pense, les cinéastes qui parviennent aujourd'hui à réaliser de véritables comédies dramatiques, en faisant preuve de la même intelligence dans les deux dimensions qui donnent son nom au genre. Si l'émotion est partout, c’est certainement lui, Mouret, qui nous tire le plus de rires ici, même s’il sait mettre en valeur tous ses acolytes, en les filmant avec cette tendresse qui est la sienne, parfois aussi avec ce soupçon de désir (pas forcément sexuel) qui est au cœur de ses films et qui semble par moments porter la caméra (comme il pouvait porter celle d'un Rohmer). Et je ne suis pas triste de constater, ou plutôt de vérifier, qu'en matière de désir, notre cher cinéaste aime le corps féminin de la tête aux pieds, sans négliger ces derniers (je crois qu’Emmanuel et moi avons le même film de chevet :
Turbulences à 30 000 pieds).
Caprice d'Emmanuel Mouret avec Emmanuel Mouret, Virginie Efira, Anaïs Demoustier et Laurent Stocker (2015)