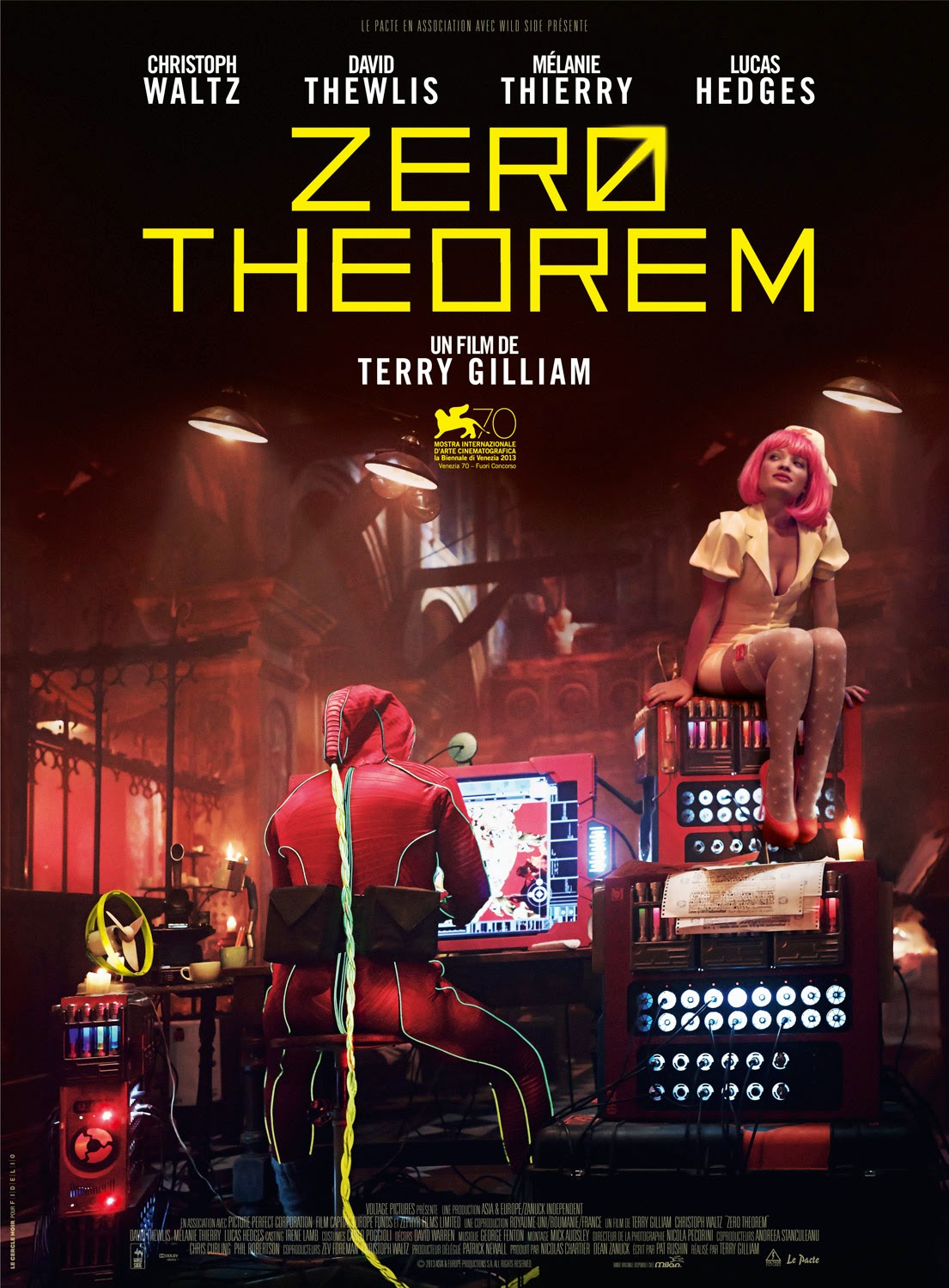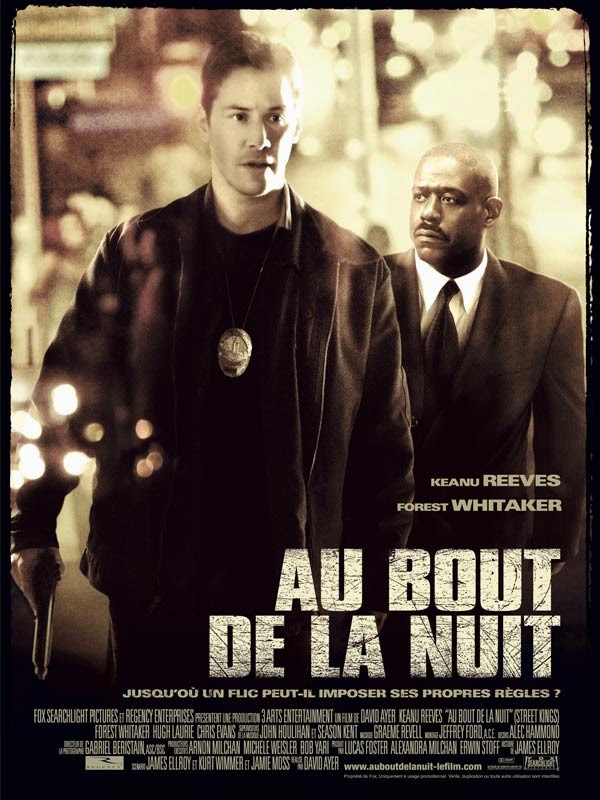A ce titre, un bonus du dvd collector du film vaut carrément le détour, où l'on voit Frankie Darabont et ses deux stars, enfermés dans une pièce obscure, interrogés tour à tour par un interviewer musclé tout droit sorti des pires heures de la Stasi ou de la Gestapo (en tout cas de la Guerre Froide quand elle était la plus chaude). Le malabar leur demande comment ils justifient l'insolente domination de leur bébé au sommet du plus gros baromètre cinéphilique existant. Éclairé par un spot de flic, les yeux dilatés comme jamais et chaque imperfection de peau éclatée sous la chaleur, Morgan Freeman, étrangement pieds nus, préfère botter en touche et rejeter la faute sur ses collègues. Aux côtés d'un Tim Robbins muet comme une carpe, Darabont finit par prendre la parole pour dire "Je n'en sais rrrrrrien", avant d'avouer qu'il placerait lui-même la trilogie du
Parrain de Coppola (au moins) au-dessus de son propre long métrage, pour lequel il reconnaît avoir quand même beaucoup d'affection et auquel il a tout de même donné 9/10 sur le site coupable.
Cherchant des excuses à droite à gauche en haussant les épaules frénétiquement, le cinéaste affiche cet air de culpabilité qui l'empêche de pioncer depuis des années, et qui dans le même temps, les rares fois où il parvient à fermer l'oeil, le fait dormir comme un loir, avec une banane grande comme ça et une trique à défoncer des briques. Darabont, qui arbore dans ce bonus un t-shirt à l'effigie de Pacino dans
Le Parrain II pour se dédouaner auprès de Coppola (même si les plus attentifs auront repéré qu'il porte un futal floqué
Les Evadés, c'est-à-dire un pantalon orange de détenu carcéral), finit par émettre cette hypothèse : "Un black, un blanc, une amitié possible, ça a dû causer aux gens quatre ans avant France 98, la France black-blanc-beur, l'utopie Jospin, les années roses". Pour la petite histoire, il paraît qu'entre deux photos de Zizou et Barthez projetées sur l'Arc de Triomphe, le fameux soir du 12 juillet 1998, on pouvait voir des images subliminales de Freeman et Robbins. Dans un mot qu'il regrette aussitôt, Darabont, qui finit par penser tout haut, en vient à se demander pourquoi
La Ligne verte n'est pas numéro 2 du Top 250 des meilleurs films de tous les temps, alors qu'il avait tout fait pour reproduire sa recette à l'identique ou presque (et on en profite pour dire RIP MCD, Michael Clarke Duncan, à qui le régime Dunkan aura été fatal après avoir fait de lui une montagne de muscles et de vitamines).

Tous les gens qui sont parvenus au bout des 142 minutes que dure le film se sont en fait probablement notés eux-mêmes sur IMDb, pressés d'attribuer une bonne note à leur preuve de sérieux face à un film académique et interminable mais bourré de belles et grandes valeurs. Plusieurs scènes de ce film, qui se donne le temps de les distiller, nous ont marqués, comme elles ont dû marquer les presque deux millions de personnes qui l'ont porté aux nues sur l'Internet Movie Database. D'abord cette scène où Tim Robbins, après avoir accumulé les petits écarts de conduite honorables voire héroïques (diffusion de musique classique dans toute l'enceinte de la prison ; bavardages à la cantoche du pénitencier ; jeux de mains jeux de vilain dans la cour de récré du bâtiment ; retard de retour de prêts à la BU centrale de l'établissement ; diffusion de magazines cochons porno gay dans les dortoirs ; détériorations des murs de sa cellule à peine dissimulées par un poster de Kim Kardashian, etc.) ressort de son cachot après une bonne semaine de mitard avec un sourire jusqu'aux oreilles (à croire qu'il connaissait déjà la note du film sur IMDb), à peine amaigri et en pleine possession de ses moyens, l'humeur au beau fixe, comme s'il venait de descendre un gros bol de chicorée.

Là ses amis détenus, effarés, s'attroupent autour de lui pour lui demander le secret de son bonheur, vu qu'aucun d'eux n'est sorti indemne d'une telle expérience. Et Tim Robbins, les mains dans les poches (comme dans chaque scène de ce film), décontracté comme jamais, répond en mangeant les syllabes et en tapotant ses tempes avec le bout de ses deux index : "Dans mon crâne c'était la Symphonie Fantastique, c'était le Casse-Noisette en boucle, c'était Everything in its right place, c'était Kid A, c'était No Woman No Cry, j'avais tout ça qui tournait dans ma tronche, tout Beethove en mode shuffle, tout Bach en stéréo, tous les grands romantiques, la fine fleur !" Le personnage explique donc là qu'avec un tout petit peu de culture gé et de musique dans la caboche il est facile de se tirer des situations les plus périlleuses. Ce genre d'idées, ça passe encore dans un Disney, dans
Les Aristochats, où on imaginerait sans mal le gros chat siamois pédé expliquer à ses collègues qu'il s'en est tiré face à un gros clébard grâce à sa connaissance des tubes de Miles Davis, mais dans la bouche de Tim Robbins, dans un film pour adultes censé nous dépeindre la vie des taulards, avouons que la pilule a du mal à passer, même vingt ans après la sortie du film.
The Sawshane Redemption a donc su séduire son public (celui-là même qui voterait en masse et dès demain pour la réhabilitation de la peine de mort ou pour son maintien, selon les pays), grâce à de grands discours sur le rachat, la réinsertion, la sociabilisation des détenus et leur salut par la culture : on voit tous les prisonniers écouter Mozart les larmes aux yeux, tournés vers les haut-parleurs de la prison comme des demeurés, s'empiffrer des livres de la bibliothèque du centre tenue par un vieux crouton adorable, se branler devant les films du répertoire dans une salle de ciné privée, et ainsi de suite, toujours avec Tim Robbins aux manettes, le personnage décidément parfait, imprenable, injouable et pourtant joué par un grand dadet d'un mètre sur deux dont le seul fait réellement héroïque est de s'être agrippé à jamais aux obus de Susan Sarandon et d'avoir reproduit le modèle et ses armes mammaires de destruction massive en son sein, avec son accord. Et puis il y a aussi de l'humour là-dedans, de la vanne à qui mieux mieux, car un tel sujet est forcément propice à la franche marade et à la bonne rigolade. Quid de l'inévitable scène de douche avec savonnette (savon de marseille glissé là par un personnage de vieux nazi qui finira par se trouver du cœur à force d'écouter Schubert matin, midi et soir et de lire de ces romans d'aventure qui permettent aux évadés de s'évader), où c'est toujours un choc de se découvrir tout nu, surtout quand le Tim Robbins en question, malgré sa taille de bûcheron, découvre au-dessus de sa tête le tronc de sequoia géant de Morgan Freeman, l'homme libre que son blaze annonce.

Au sommet de cette montagne d'humour, de ce comique qui plaît à tout le monde, dont Stephen King a le secret en bon héritier de Walter Disney (facho entre guillemets), il y a ce gimmick monstrueusement comique, d'une drôlerie noire que même Todd Solondz n'aurait jamais imaginée et dont Gotlib n'aurait pas osé faire sa quatrième de couv', où le triste Morgan Freeman, à deux doigts de la retraite chaque année, tête baissée (comme toujours dans ce film), va demander à un guichetier de la prison si cette fois-ci c'est la bonne, la quille, la perm', l'issue de secours, la liberté pour le dire d'un mot, quand systématiquement l'agent d'accueil lui retourne une
feuille tamponnée en lui disant : "Tiens ça bien au chaud, c'est un bon pour un an de bonus en taule, parmi nous, à l'année prochaine, même heure même endroit gros connard !" Les dialogues varient de trois quatre mots à chaque nouveau jour de l'an, d'une demi-phrase, le "bon pour un an" devenant un "ticket resto", le "un an de bonus en taule" changeant pour "une pige de plus dans le caftard" ou le "gros connard" final trouvant une variante subtile dans un "pur enfoiré" bien placé, mais globalement la scène revient systématiquement et à intervalles réguliers comme autant de répétitions espacées, supposées nous donner le sentiment d'éternité du bagne et qui trahissent au contraire l'incapacité de Darabont à nous faire ressentir le poids des années, le temps qui passe, tant on a l'impression que Freeman tente sa chance tous les matins, sans cesse ramassé à la petite cuillère par un Tim Robbins compatissant mais lassé.

La bonne recette de Darabont c'est le mélange de cet humour décapant et d'un sens aigu du drame, le pire qui soit : l'injustice. Tim Robbins nous est présenté dès le début du film comme un
innocent, accusé et condamné à tort, une belle âme pure et lettrée, charitable et solidaire, dénuée de la moindre trace de dualité. Idem pour Freeman, forcément victime de sa couleur de peau et enfermé pour avoir répondu à une insulte raciste parmi tant d'autres en fumant littéralement son agresseur, brûlé vif dans un remake sans échappatoire de la torche humaine (légitime défense drôlement élaborée et mise au point par un détraqué total que le film veut innocenter alors qu'il a carrément sa place entre quatre murs). Tous les prisonniers ont leur petit quart d'heure de gloire, où ils finissent par avouer autour d'un feu de camp pourquoi ils sont là, et pour chacun d'entre eux il y avait bien sûr une "bonne excuse". Allons-y de l'ancien nazi qui se repent d'avoir apporté sa petite pierre à l'édifice d'Auschwitz-Birkenau en se prévalant d'avoir des amis juifs et de n'avoir fait qu'obéir aux ordres, avec certes un certain zèle mais comme poussé par le "souffle de l'époque", dit-il en plaçant le bout de son index et de son majeur collés l'un contre l'autre sous son nez de façon tout de même assez douteuse. C'est aussi le vieux bibliothécaire regrettant d'avoir organisé quelques auto-dafé de livres juifs sur la Berlin Alexanderplatz avec quelques personnes jetées au milieu des flammes dans un remake de Jeanne D'Arc. Ou encore ce personnage qui traverse le film sans dire un mot, comme un fantôme, toujours à l'arrière-plan, et qui partage sa peine d'avoir traîné sur trois cent kilomètres le cadavre d'un agent de la DDE coincé sous le pare-buffle de sa bécane sans s'en rendre compte, par un soir de brouillard maudit.
A la fin du film, nos deux tourtereaux enfin libres se retrouvent sur la plage dans une ambiance bon enfant quand Morgan Freeman déplie sa serviette de bain pour l'étendre sur le sol sous les yeux écarquillés de Tim Robbins, qui découvre qu'elle n'est autre que la peau du fameux guichetier qui lui refusait chaque année son bon de sortie, tannée par un expert en taxidermie. Deux plans plus loin, Freeman, léger comme un pinçon et heureux comme un gosse, sort de son sac de plage un ballon de volley-ball qui n'est autre que la tête coupée de l'agent d'accueil, tamponnée sur le front, et Morgan, l'homme plus libre que libre, de proposer à son acolyte un petit match tout en dévoilant un maillot fait de peau humaine, revêtu en prime du masque de Scream, devant un Robbins qui commence à penser que le guichetier du bahut avait quand même le compas dans l’œil pour repérer les malades. Au spectateur quant à lui de saisir ici la patte du King, habitué aux horreurs et qui ne peut s'empêcher de glisser, y compris dans ses comédies, des instants de pure sauvagerie (quid de cette scène de
Misery où James Caan se fait ratiboiser le pied dans un scénario pourtant léger signé Rob Reiner, le gros fêtard d'Hollywood). Bref tout était là pour que le film plaise aux masses malgré un
happy end au goût amer, et il n'est pas étonnant que
The Shoeshane Redemption culmine au firmament des plus grandes œuvres cinématographiques de tous les temps. Darabont, nostalgique de son succès dès le lendemain de la première avant-première, a voulu remettre le couvert à maintes reprises en réadaptant le King à toutes les sauces, y compris les pires brouillons de l'écrivain écrits sur les quatre coins de son lit de mort à l'hosto, mais ces tentatives n'ont donné que de plus relatifs succès tels que
La Ligne verte et
The Mist, et quelques autres films qui en fait ne sont pas de Darabont.